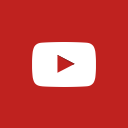Dossier 2026 — Retour au bureau
Épisode d’ouverture 2026 (diffusion simultanée BB + CN)
On reprend, mais on reprend bien******.
Pour ce premier rendez-vous de l’année, un épisode court et clair : le plan de route 2026 de Bobards sur Bobines et Chroniques Noires, avec le même rythme de publication… et des nouveautés qui donnent du coffre.
Ce qui vous attend en 2026****
Même cadence : un vendredi BB, le suivant CN, et ainsi de suite
Plus des épisodes spéciaux, côté cinéma et côté littérature
BB : focus réalisateur, acteur, studio, et “coulisses” (codes, systèmes, histoires derrière l’écran)
CN : focus auteur, genre, maison d’édition, collection, et dossiers thématiques
Une promesse simple : du contenu plus riche, plus structuré, sans devenir “prise de tête”
Qui tient le dossier******
SAM à la narration
Jean-Claude (LeJC pour les intimes) à tout le reste : enquêtes, recherches, écriture, montage, publications
Et la suite ?******
Quelques affaires sont déjà “dans les tuyaux**” — sans titres, sans auteurs, sans spoilers — côté films et côté romans.
Le reste arrive, dossier après dossier, chaque vendredi.
Bienvenue en 2026. On rouvre le bureau.